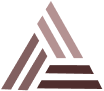Le présent glossaire est consacré aux termes d’architecture arménienne durant la période paléochrétienne et médiévale de son développement. S’agissant de l’Arménie, il faut donner à l’expression « période paléochrétienne et médiévale » une longue portée qui s’étend de l’Antiquité tardive, c’est-à-dire de l’adoption du christianisme au début du IVe s. jusqu’aux Temps modernes, aux XVIIe-XIXe s. Cette période d’environ un millénaire et demi constitue un cadre unique durant lequel, malgré de nombreux bouleversements, les mêmes structures sociales, grosso modo, se sont maintenues et la vie culturelle, artistique et intellectuelle arménienne s’est déroulée, pour l’essentiel, sous l’emprise de l’Église.
L’architecture, volet majeur de l’art arménien
L’art médiéval arménien se décline en trois grands domaines :
– l’architecture, surtout religieuse, mais aussi civile et militaire, et son décor sculpté,
– l’enluminure (la miniature, peinture dans les livres) et, dans une moindre mesure, la peinture monumentale (les fresques),
– l’art des monuments crucifères et des khatchkars (les pierres-croix).
Quant aux arts « mineurs », céramique, textile (surtout tapis), orfèvrerie (travail des métaux précieux), sculpture sur bois…, ils ont davantage souffert des vols et des destructions et sont moins bien représentés. Ils occupent donc une place relativement secondaire, même s’ils ont produit des œuvres de grande qualité.
Parmi ces trois domaines majeurs, l’architecture est au centre de l’attention dans le présent glossaire. L’architecture a en effet une valeur emblématique et une « aura » exceptionnelle, car c’est là sans doute, à côté des enluminures et des khatchkars, que les Arméniens ont donné le meilleur de leur génie artistique. L’architecture a produit un nombre impressionnant de monuments de haute qualité, reconnaissables entre tous par leur langage technique et esthétique très original. C’est pourquoi une place importante revient à l’architecture arménienne dans l’histoire universelle des arts. En même temps, ce riche patrimoine est partie intégrante et précieuse de l’héritage commun de l’humanité.
Les problèmes terminologiques sont une grave entrave
Le vocabulaire qui permet la description et l’étude de l’architecture arménienne est complexe et souvent spécifique, car appliqué à des formes propres à cet art. Cette terminologie est souvent mal comprise, donc mal utilisée, ce qui entrave l’étude des monuments et rend imparfaite leur compréhension, donc leur présentation au plus grand nombre.
Les imprécisions, erreurs et divergences sur l’interprétation des termes gênent les échanges entre chercheurs de diverses langues et cultures.
C’est pourquoi, après avoir fait l’expérience des difficultés et des enthousiasmes suscités par l’étude de l’histoire de cet art, nous, enseignants, étudiants et professionnels du patrimoine, avons décidé d’élaborer un glossaire dans lequel seraient définis et expliqués les termes propres à l’architecture arménienne.
Spécificités du glossaire
A) Dans son état actuel, le glossaire se présente dans une version bilingue français – arménien oriental, mais il est appelé à devenir polyglotte dans un avenir un peu plus lointain, les prochains développements visant l’arménien occidental, l’anglais, le russe, l’allemand et plusieurs autres langues.
B) Les rédacteurs se sont efforcés, premièrement, de trouver les termes précis désignant les éléments propres à cette architecture, deuxièmement, de les définir de manière complète, claire et rigoureuse, troisièmement, de trouver, pour l’heure dans les deux premières langues, des équivalents aussi exacts et compréhensibles que possible de ces termes.
C) Le glossaire comporte obligatoirement un important volet d’illustrations. En effet, la définition de termes spéciaux destinés à désigner les éléments d’un domaine relativement difficile, très original, ne peut pas se passer de traductions visuelles. C’est pourquoi, presque chaque entrée du glossaire s’accompagne d’une ou de plusieurs illustrations photographiques et, si nécessaire, graphiques, ainsi que de plans, munis de légendes pouvant être assez détaillées.
D) Enfin, sans exclure, à terme, la perspective d’une publication sur papier, le glossaire est pour l’heure diffusé en ligne, afin que tous ceux qui souhaiteront y participer puissent à tout moment proposer des corrections et compléments.
Objectifs du glossaire
La science s’efforce de recenser et d’étudier minutieusement les ouvrages d’architecture ancienne, de donner une description exacte, puis une analyse fiable de leurs traits caractéristiques. Pour bien exécuter cette tâche, elle a besoin d’une terminologie rigoureuse, comprise par tous de la même façon.
Les concepteurs du présent glossaire espèrent que les chercheurs, qu’ils soient confirmés ou débutants, y trouveront un outil qui facilitera et stimulera leurs travaux et leurs échanges. Ils souhaitent également que les professionnels du patrimoine et du tourisme, ainsi que l’ensemble des lecteurs intéressés par le sujet, en s’emparant de cet essai de guide terminologique, se dotent des clefs qui leur permettront de mieux comprendre et connaître, donc de mieux présenter, étudier, protéger et sauvegarder l’un des plus riches chapitres de la culture de l’Arménie et de l’ensemble du monde médiéval.
Merci de transmettre vos observations, critiques et suggestions en écrivant à : patrick.donabedian@univ-amu.fr